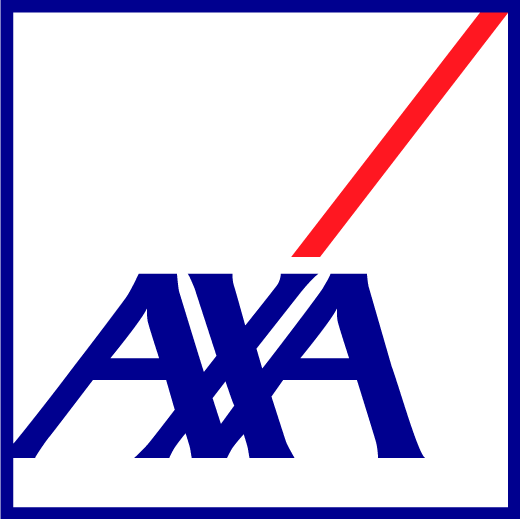Alors que l’agriculture européenne traverse une période de profondes tensions, marquée par les mobilisations d’agriculteurs contre les normes environnementales et la réforme de la PAC, une autre crise, plus silencieuse mais tout aussi alarmante, continue de s’aggraver : celle du déséquilibre des cycles de l’azote et du phosphore. En janvier 2025, un rapport conjoint de l’Agence européenne pour l’environnement (AEE) et de l’ONU Environnement a confirmé que ces deux nutriments, massivement utilisés sous forme d’engrais minéraux et organiques, s’accumulent dans les écosystèmes à des niveaux largement supérieurs à leur capacité d’absorption.
Pour mieux comprendre les mécanismes en jeu et les leviers d’action possibles, nous avons interrogé Sylvain Pellerin, directeur de recherche à l’INRAE. Référent national sur les cycles biogéochimiques du carbone, de l’azote et du phosphore, il travaille depuis plus de trente ans sur les interactions entre systèmes agricoles et environnement global. À la lumière de ses recherches, il alerte sur l’urgence de réinventer nos pratiques agricoles pour rester dans les limites planétaires.
1. Pourquoi l’azote et le phosphore sont-ils essentiels à l’agriculture ?
L’azote et le phosphore sont des éléments nutritifs indispensables au bon développement des plantes. Ils interviennent dans la croissance végétative, la constitution des protéines, et donc dans toute la chaîne alimentaire. Comme le rappelle Sylvain Pellerin, « une plante qui ne trouve pas dans le sol l’azote et le phosphore dont elle a besoin ne peut pas pousser ». Ces besoins sont considérables : une culture de céréales retire chaque année entre 15 et 20 kg de phosphore et entre 100 et 200 kg d’azote par hectare.
Même si ces éléments sont naturellement présents dans l’environnement, le diazote représentant par exemple 80 % de l’air, ils ne sont pas directement assimilables par la majorité des plantes. Seules certaines espèces comme les légumineuses, grâce à des bactéries symbiotiques, peuvent capter l’azote atmosphérique. Quant au phosphore, bien que présent dans les sols, il est peu mobile, donc difficilement disponible.
Cette réalité a conduit à un recours massif aux engrais chimiques, en particulier depuis le début du XXe siècle, après que le chimiste Bosch a mis au point un procédé permettant de fabriquer de l’ammonium à partir de l’azote de l’air. Cela a ouvert la voie à une fertilisation minérale intensive, qui s’est considérablement amplifiée dans les années 1960 dans un contexte de croissance démographique rapide.
2. Quels sont les effets environnementaux de la perturbation des cycles de l’azote et du phosphore ?
L’intensification de l’agriculture a certes permis de nourrir une population croissante, mais elle a aussi profondément perturbé les cycles naturels de l’azote et du phosphore. Sylvain Pellerin insiste sur le fait que l’azote, en particulier, est un élément très mobile et très réactif. Il circule facilement entre l’air, l’eau et le sol, ce qui le rend difficile à contenir. Une fois appliqué en excès dans les champs, il se retrouve dans des compartiments naturels non ciblés, avec de nombreuses conséquences néfastes.
La première conséquence historique est la contamination des nappes phréatiques par les nitrates (une forme d’azote), ce qui dégrade la qualité de l’eau potable. Vient ensuite l’eutrophisation des milieux aquatiques, provoquée par l’accumulation d’azote et de phosphore dans les eaux douces ou marines. Cela favorise la prolifération d’algues qui, en se décomposant, consomment l’oxygène dissous et créent ce que l’on appelle des zones mortes. « Ces apports déclenchent une prolifération d’algues […], puis la biomasse meurt, consomme l’oxygène et les poissons meurent », explique-t-il.
À ces impacts s’ajoutent des problèmes de qualité de l’air, car l’ammoniac libéré dans l’atmosphère par l’épandage d’engrais azotés est un précurseur de particules fines nocives pour la santé humaine. Enfin, l’un des effets les plus préoccupants est l’émission de protoxyde d’azote (N₂O), un gaz à effet de serre extrêmement puissant. « Le protoxyde d’azote est 300 fois plus réchauffant que le CO₂ », rappelle Pellerin. Autrement dit, ce que l’on considérait comme un problème agricole local devient aujourd’hui un enjeu global qui touche à la fois le climat, la biodiversité, la santé publique et les équilibres écosystémiques.

Selon un rapport publié en janvier 2025 par l’Agence européenne pour l’environnement et l’ONU Environnement, les apports d’azote et de phosphore liés à l’agriculture excèdent de 30 à 50 % la capacité d’absorption naturelle des écosystèmes en Europe, provoquant une eutrophisation croissante des sols et des eaux.
3. Peut-on nourrir une population de 9 milliards d’humains sans engrais de synthèse ?
Cette question est au cœur des débats sur la transition agricole. Si les engrais ont permis de tripler les rendements agricoles en un demi-siècle, leur suppression complète poserait de sérieux problèmes de sécurité alimentaire. Sylvain Pellerin a exploré un scénario dans lequel l’agriculture mondiale serait 100 % biologique, donc sans recours aux engrais chimiques. Le résultat est sans appel : « On a trouvé une chute de la production végétale de l’ordre de –57 % », ce qui signifierait une crise alimentaire majeure à l’échelle planétaire.
Toutefois, un scénario plus modéré, dans lequel 60 % de l’agriculture deviendrait biologique, semble envisageable, à condition d’accompagner ce changement par des transformations majeures de nos modes de consommation. Il faudrait d’abord réduire considérablement le gaspillage alimentaire. Aujourd’hui, environ 25 % de la production est jetée. Si cette perte était évitée, la quantité de nourriture à produire serait mécaniquement réduite, tout comme l’usage des engrais.
Il serait également indispensable de rééquilibrer notre régime alimentaire, en réduisant la part de produits d’origine animale, très gourmands en ressources. « Une grande partie des surfaces qu’on cultive […], c’est pour nourrir des animaux », rappelle Sylvain. Réduire la viande, ce n’est pas seulement une question de climat, c’est aussi une manière de diminuer l’usage des engrais.
Écoutez le podcast et découvrez l’interview dans son intégralité : perturbation des cycles biogéochimiques de l’azote et du phosphore l’érosion de la biodiversité.
4. Quels leviers concrets peuvent permettre une agriculture plus durable ?
Pour réduire l’impact des engrais tout en maintenant une production agricole suffisante, plusieurs leviers peuvent être actionnés simultanément. Sur le plan technique, il est possible d’améliorer la gestion de la fertilisation en affinant les doses, en ajustant le calendrier d’application, et en valorisant mieux les engrais organiques, comme les fumiers ou les lisiers.
Ceux-ci sont souvent sous-estimés, ce qui pousse les agriculteurs à ajouter des engrais de synthèse en excès. Le développement des légumineuses, comme les pois, lentilles ou haricots, constitue également un levier puissant. Ces plantes ont la capacité de fixer l’azote de l’air grâce à des bactéries situées dans leurs racines, ce qui permet de limiter les besoins en engrais chimiques.
À une échelle plus large, l’organisation territoriale des productions agricoles joue un rôle clé. Aujourd’hui, la spécialisation des régions, élevage en Bretagne, grandes cultures dans le Bassin parisien, empêche un recyclage efficace des nutriments. « En Bretagne, on a trop d’azote et de phosphore. Dans le Bassin parisien, on utilise des engrais de synthèse », explique Sylvain.
Reconnecter élevage et cultures permettrait de boucler les cycles biologiques et d’éviter les excès comme les manques. Enfin, les habitudes alimentaires jouent un rôle fondamental. En mangeant moins de viande et davantage de protéines végétales, nous allégeons la pression sur les terres agricoles. « Aujourd’hui, on consomme deux tiers de protéines animales. Si on inversait ce ratio, ce serait bon pour la planète », affirme-t-il.
5. En quoi cette problématique s’inscrit-elle dans la logique des limites planétaires ?
La perturbation des cycles de l’azote et du phosphore est l’une des neuf limites planétaires définies par la science, et elle fait partie des plus critiques, car les dépassements observés sont massifs. Comme l’explique Sylvain Pellerin, ce qui était autrefois perçu comme un problème local devient aujourd’hui un enjeu planétaire. La diffusion mondiale des engrais, la pollution transfrontalière des mers, ou les émissions de protoxyde d’azote sont autant de signes de cette transformation. Cela justifie l’émergence d’une réflexion à l’échelle globale sur les seuils à ne pas franchir.
Cependant, il ne faut pas considérer cette limite isolément. Les limites planétaires interagissent entre elles. Réduire l’usage des engrais a des effets positifs sur la qualité de l’air, sur la biodiversité, sur le climat et sur la santé humaine. Ce sont des synergies bénéfiques. Mais des effets rebond sont aussi possibles. Par exemple, si l’on diminue les engrais sans modifier les régimes alimentaires, la chute des rendements peut entraîner une expansion des terres cultivées, et donc une déforestation accrue. « Si on réduit les rendements, mais qu’on ne change pas nos habitudes, il faudra plus de terres. Et si on défriche, on émet du CO₂ et on nuit à la biodiversité », met en garde Sylvain.
La recherche scientifique actuelle vise donc à modéliser des scénarios à grande échelle, en croisant les dimensions agricoles, alimentaires et climatiques. « L’effort de recherche est beaucoup là-dessus maintenant : modéliser des scénarios pour alimenter les politiques publiques », conclut-il. Car c’est bien cette articulation entre la science, l’action politique et les comportements individuels qui permettra de préserver les équilibres planétaires tout en assurant la sécurité alimentaire mondiale.
———————————————————
Sylvain Pellerin est directeur de recherche à l’INRAE (Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement), au sein du centre Nouvelle-Aquitaine-Bordeaux, et membre de l’unité mixte de recherche ISPA (Interactions Sol Plante Atmosphère). Agronome et écologue de formation, il travaille depuis plus de 30 ans sur les grands cycles biogéochimiques, en particulier ceux de l’azote, du phosphore et du carbone, et leurs perturbations sous l’effet de l’agriculture intensive. Spécialiste reconnu des enjeux de durabilité dans les systèmes agricoles, il a contribué à plusieurs expertises scientifiques pour les ministères français, la Commission européenne et des organismes internationaux. Il a également co-dirigé le programme Climae, une initiative nationale pionnière sur les interactions entre changement climatique et agriculture.