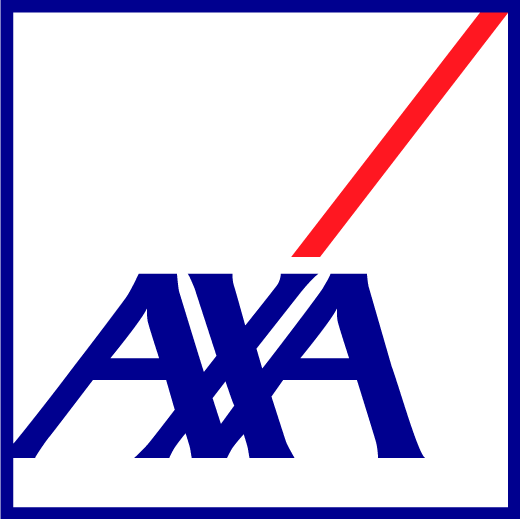Plus de 350 000 substances chimiques sont aujourd’hui recensées dans le commerce mondial, un flux continu d’entités nouvelles qui pousse l’humanité au-delà d’une des limites planétaires les plus critiques. Géographe de formation, expert en économie circulaire et spécialiste des systèmes environnementaux, Henri Bourgeois-Costa œuvre au sein de la Fondation Tara Océan, où il accompagne la recherche scientifique et les actions de sensibilisation sur la pollution plastique et les substances chimiques émergentes qui menacent notre biosphère.
Il répond aujourd’hui à cinq questions sur cette limite planétaire souvent méconnue : l’introduction d’entités nouvelles, microplastiques, perturbateurs endocriniens, produits radioactifs, qui bouleversent durablement les équilibres des écosystèmes terrestres et marins.
1. Que sont les entités nouvelles et pourquoi constituent-elles une limite planétaire majeure ?
Les entités nouvelles désignent l’ensemble des substances artificielles introduites par l’activité humaine dans l’ environnement.
Leur apparition est directement liée à l’essor technologique et industriel, souvent sans considération pour les impacts environnementaux à long terme : « Elles sont apparues des besoins de la production industrielle et des capacités techniques que l’humanité a acquises […], sans avoir une vision extrêmement précise de l’impact du transfert de ces entités vers l’environnement. »
La gravité de cette limite planétaire repose sur une règle stricte : une tolérance zéro. « La limite planétaire que les scientifiques ont définie, c’est une limite zéro. À partir du moment où on introduit de nouvelles entités, et qu’on n’est pas capable de dire qu’elles sont absolument neutres, qu’on est à même d’éviter toute fuite dans l’environnement […], il faut les éviter. » Henri insiste : « aujourd’hui, le constat est très clair : on utilise des entités qui sont largement perturbatrices. Cette limite est très largement dépassée. »
2. Pourquoi le plastique incarne-t-il si bien cette problématique des entités nouvelles ?
Le plastique est emblématique de cette crise car il est omniprésent et chargé d’additifs chimiques. Henri l’explique clairement : « le plastique, ce sont des matériaux de synthèse […] basés sur une chimie du carbone, issus du pétrole. […] On les chiffre à plusieurs milliers, 16 000 selon les données, qui vont venir améliorer leur performance technique mais également ajouter de la complexité à leur impact. »
Ce matériau est désormais partout : « les seuls endroits où on ne les trouve pas, c’est les endroits où on ne les cherche pas. […] On les trouve dans notre alimentation, dans l’air que nous respirons, dans nos propres cellules. » Ce constat souligne une contamination globale et incontrôlée.
Les conséquences sont à la fois visibles et invisibles : des millions d’oiseaux et de mammifères marins meurent chaque année, mais « ils ne sont que la partie émergée de l’iceberg ». La majorité des plastiques présents dans l’environnement sont des microplastiques, inférieurs à 5 mm, qui « vont pénétrer beaucoup plus profondément dans la chaîne alimentaire ».
Plus de 350 000 produits chimiques de synthèse sont actuellement enregistrés pour la production et l’utilisation commerciale dans le monde.
(Source : Persson et al., 2022 – Environmental Science & Technology)
Ces particules ont deux effets majeurs : physiques (elles empêchent les organismes de se nourrir correctement) et chimiques : « un quart des additifs sont problématiques pour la santé environnementale ou humaine. » De plus, elles agissent comme des « aimants » à toxiques (pesticides, métaux lourds, hydrocarbures) et comme supports biologiques : « ces microplastiques vont également servir de support à des virus, bactéries […]. On crée ainsi une plastisphère, une composante vivante fondamentalement différente de ce que l’Holocène a connu. »
3. Existe-t-il des solutions efficaces pour gérer ou réduire cette pollution ?
La réponse d’Henri est claire : « la solution, en fait, c’est la nature qui la contient. […] Il faut lui “fiche” la paix pour qu’elle puisse faire son travail. » Autrement dit, la priorité est avant tout la prévention, pas la collecte ou la remédiation.
La récupération des plastiques, en particulier des microplastiques, est techniquement et écologiquement irréaliste : « aller collecter des morceaux de plastique de 5 mm revient à vouloir vider les océans à la petite cuillère. Ce n’est absolument pas envisageable.» Pire, cela pourrait « enlever tous les micro-organismes qui ont colonisé ces plastiques, et provoquer un déséquilibre dont on ne connaît pas les conséquences ».
Quant au recyclage, souvent perçu comme une solution miracle, il présente de sérieuses limites : « c’est une idée qui a énormément de limites. […] Le recyclage concentre la toxicité. […] Des études montrent déjà une toxicité environnementale supérieure des plastiques recyclés vis-à-vis des vierges. »
Le scientifique plaide donc pour une réduction drastique des usages plastiques, en particulier ceux « non essentiels, très éphémères ou les plus toxiques. »
Écoutez le podcast et découvrez l’interview dans son intégralité : l’introduction de nouvelles entités dans la biosphère.
4. Quel rôle les entreprises peuvent-elles jouer face à ces enjeux ? L’économie circulaire est-elle une vraie réponse ?
Henri appelle à un changement radical dans la manière de concevoir l’économie : « l’économie circulaire ne se résume pas à la circularité des matériaux. Elle se définit comme la capacité de construire un système économique qui s’inscrive dans la circularité des grands écosystèmes. » Il évoque la maxime médicale « primum non nocere » (d’abord ne pas nuire) comme principe fondateur de ce nouveau modèle.
Pour les entreprises, cela signifie : repenser les produits, limiter l’impact à la source, privilégier les matériaux réutilisables et non toxiques, et intégrer l’impact environnemental au cœur du modèle économique :« il faut repenser notre vision de l’entreprise […] en ayant, non pas comme un item parmi d’autres, mais le sujet, l’environnement, autour duquel doivent s’articuler tous les autres. »
Mais la tâche est complexe, car même de grandes entreprises ignorent la composition exacte de leurs matériaux : « elles avouent que dans leurs formulations, elles ne savent pas exactement ce qu’il y a, car les fournisseurs protègent cela par le secret de production. » Il soutient donc les initiatives comme le traité international sur les plastiques visant à imposer la transparence des formulations chimiques.
5. Le citoyen peut-il agir à son échelle ou est-ce une illusion ?
Face à l’ampleur de la pollution par les entités nouvelles, Henri Bourgeois-Costa appelle à une certaine lucidité quant au rôle de l’individu. Selon lui, « le petit geste qui sauverait la planète est une vue de l’esprit », car nos comportements sont largement contraints par des systèmes de production, de distribution et de consommation que nous ne contrôlons pas. Il prend l’exemple du yaourt : choisir entre un pot plastique polluant ou un pot en verre jetable à forte empreinte carbone illustre bien l’impasse du consommateur isolé. « La seule vraie solution serait du vrac avec emballage réemployé localement, mais cela n’existe pas encore à grande échelle. »
En parallèle, il met en garde contre certaines innovations mal pensées, comme ces emballages composites allégés en plastique mais enrichis en additifs fluorés hautement toxiques : « on réduit le poids, mais on aggrave la toxicité. » Ces maladaptations montrent que les enjeux ne peuvent être traités séparément. Car au fond, insiste-t-il, « il n’y a pas plusieurs enjeux, il n’y en a qu’un : le vivant. » Plastique, carbone, eau… ces crises ne posent problème que parce qu’elles menacent les équilibres du monde vivant.
le réchauffement climatique, il n’y a pas de solution miracle. Dans l’idéal, il faut jouer avec tous les leviers dont on dispose et les activer en simultané.
___________________________________________
Henri Bourgeois-Costa est un expert en géographie des écosystèmes et en plaidoyer environnemental. Il travaille depuis 2019 pour la Fondation Tara Océan, où il est chargé des relations institutionnelles et du plaidoyer international, notamment sur la pollution plastique. Fort d’une longue expérience dans le secteur associatif environnemental, il intervient auprès des décideurs politiques, des industriels et dans les négociations internationales pour promouvoir une économie circulaire et la réduction des pollutions marines. Son travail se concentre sur la mise en place de solutions concrètes et juridiquement contraignantes, en particulier dans le cadre du futur traité mondial sur les plastiques.