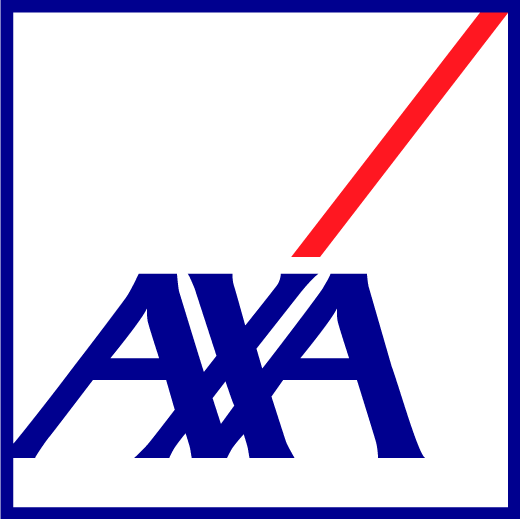La TRACC (Trajectoire de Réchauffement de Référence pour l’Adaptation au Changement Climatique) est un outil scientifique et stratégique créé par l’État français. Elle ne cherche pas à prédire précisément le climat du futur, mais à offrir une base commune, réaliste et cohérente, à partir de laquelle tous les acteurs (entreprises, collectivités, assureurs, aménageurs) peuvent préparer leurs décisions d’adaptation. Cet article résume sa logique, ses données, et comment l’utiliser concrètement au niveau des entreprises.
Qu’est-ce que la TRACC ?
À quel niveau de réchauffement la France doit-elle s’adapter ?
La TRACC et l’Accord de Paris
En quoi la TRACC diffère-t-elle des scénarios du GIEC ?
Quelles sont les données associées à la TRACC ?
À quel climat s’adapter en France selon la TRACC ?
Et maintenant, comment se servir de la TRACC ?
Qu’est-ce que la TRACC ?
Face à l’accélération du changement climatique, la France s’est dotée d’un nouvel outil : la TRACC. Elle définit une trajectoire de réchauffement unique pour la France métropolitaine et la Corse, basée sur un ensemble de données de projections climatiques.
L’objectif est double :
1. Mieux anticiper les impacts à venir du changement climatique.
2. Construire des politiques d’adaptation cohérentes sur la base d’une référence commune et permettre à tous les acteurs d’adopter les mêmes hypothèses pour répondre à la question : « À quel climat futur devons-nous nous adapter ? » [1].
Définie en 2023 par le ministère de la Transition écologique, la TRACC constitue le socle scientifique du 3e Plan national d’adaptation au changement climatique (PNACC-3). Météo-France en a détaillé la construction et les implications dans son rapport « À quel climat s’adapter en France selon la TRACC ? » [1, 2].
À quel niveau de réchauffement la France doit-elle s’adapter ?
La TRACC adopte une approche spécifique dite « par niveaux de réchauffement »
Celle-ci a été largement utilisée pour documenter les impacts du réchauffement climatique dans le dernier rapport du GIEC. Le GIEC considère des scénarios, nommés Shared Socioeconomic Pathways (SSP), qui décrivent différents futurs possibles selon l’évolution des choix économiques, technologiques et politiques. À partir de ces trajectoires socio-économiques, on en déduit les émissions de gaz à effet de serre (GES). Celles-ci sont intégrées dans les modèles climatiques globaux qui simulent le réchauffement et ses effets.
Une incertitude inhérente aux modèles
Les modèles étant différents, ils simulent des vitesses de réchauffement variées pour un même scénario. Ainsi, pour un même scénario, comme le SSP2-4.5 (considéré comme intermédiaire), le réchauffement prévu à l’horizon 2050 est de +1,6 °C à +2,5 °C, avec une estimation centrale de +2 °C. Il existe donc une incertitude sur le niveau de réchauffement, pour un scénario donné, qui doit être prise en compte dans les analyses.
Construction de la trajectoire TRACC pour la France
L’idée sous-jacente à l’approche par niveaux de réchauffement est que de nombreux impacts dépendent avant tout du niveau de réchauffement climatique global, et pas tant du moment ni de la vitesse à laquelle ce niveau est atteint (notons que ce n’est pas vrai pour tous les impacts, par exemple l’élévation du niveau de la mer dépend d’à quelle vitesse les calottes glaciaires fondent donc d’à quelle vitesse celles-ci se réchauffent).
La TRACC retient trois niveaux de réchauffement aux horizons 2030, 2050 et 2100. Ces valeurs, recommandées par la communauté scientifique, ont été établies en deux étapes :
1. D’abord, le constat est que les politiques publiques actuelles des pays nous mettent sur la trajectoire d’un réchauffement climatique global d’environ +2 °C en 2050 et +3 °C en 2100 [3].
2. Ensuite, une correspondance est établie entre les niveaux de réchauffement globaux et les niveaux de réchauffement sur la France métropolitaine [4].

Figure 1 : Correspondance entre les niveaux de réchauffement planétaire et à l’échelle de la France hexagonale. Source : “À quel climat s’adapter en France selon la TRACC ?” partie 1 [1]
La TRACC fournit donc des niveaux de réchauffement plausibles auxquels les politiques publiques, les entreprises et les territoires doivent apprendre à s’adapter.
La TRACC et l’Accord de Paris
En 2015, les pays du monde entier ont signé l’Accord de Paris, par lequel ils s’engagent à limiter le réchauffement climatique en dessous de +2 °C et, si possible, à +1,5 °C. Alors que le réchauffement est estimé à environ +1,4 °C pour l’année 2024, la communauté scientifique a récemment constaté que l’objectif de +1,5 °C n’est plus tenable, car il impliquerait de ramener les émissions de GES à zéro à un rythme insoutenable.
Le choix de niveaux de réchauffement global supérieurs à +2 °C dans la TRACC ne signifie pas que la France abandonne ses engagements au titre de l’Accord de Paris. Le constat est que les engagements actuels des États ne permettent pas de tenir l’Accord de Paris. Pour autant, la réduction de nos émissions de GES doit rester une priorité afin de limiter au maximum le réchauffement climatique et faire notre part pour respecter l’objectif de +2 °C.
En quoi la TRACC diffère-t-elle des scénarios du GIEC ?
Les niveaux de réchauffement global considérés par la TRACC sont proches de ceux simulés dans le scénario intermédiaire du dernier rapport du GIEC (il s’agit du scénario SSP2-4.5 « middle of the road » dans lequel les émissions de GES sont réduites, mais pas suffisamment pour maintenir le réchauffement global sous 2°C). Néanmoins, la TRACC étant conçue pour la France, ce sont les niveaux de réchauffement sur la France qu’il faut considérer. Pour ceux-ci, la TRACC est proche du scénario de très fortes émissions en 2030 et 2050, et se situe entre le scénario intermédiaire et celui de très fortes émissions à l’horizon 2100.

Figure 2 : Réchauffement sur la France simulé par l’ensemble de simulations Explore-2 sur la période 1976-2100 selon trois scénarios climatiques RCP2.6 (faibles émissions), RCP4.5 (intermédiaire) et RCP8.5 (fortes émissions). Le réchauffement est calculé par rapport à la moyenne 1976-2005. SAFRAN (pointillés noirs) correspond aux observations historiques. Les niveaux de réchauffement de la TRACC à l’horizon 2030, 2050 et 2100 sont représentés par des étoiles jaunes, orange et rouges. Source : « À quel climat s’adapter en France selon la TRACC ? », partie 1 [1].
Notes sur les scénarios du GIEC: Le 6e et dernier rapport du GIEC, publié en 2021, utilise des scénarios appelés SSP (pour Share Socioeconomic Pathways). Le 5e rapport, publié en 2013 utilisait des scénarios dit RCP (pour Representative Concentration Pathways). Les simulations pour la TRACC étant basées sur les simulations climatiques du 5e rapport du GIEC, la comparaison au niveau français ne peut se faire qu’avec les scénarios RCP utilisés pour ce 5e rapport.
Quelles sont les données associées à la TRACC ?
Les projections climatiques de la TRACC se basent sur un ensemble de projections climatiques dénommé Explore-2. Cet ensemble repose sur 17 simulations climatiques de modèles régionaux qui déclinent, à l’échelle européenne, les simulations climatiques globales ayant servi de base au 5e rapport du GIEC (2013). L’adjectif « régional » doit s’entendre au sens d’une région du monde, ici l’Europe.
Il s’agit des simulations à l’échelle européenne les plus récentes (les simulations à l’échelle européenne basées sur les simulations globales ayant servi de base au 6e rapport du GIEC sont toujours en cours de réalisation). Ces simulations ont été projetées sur la France métropolitaine à une résolution de 8 km et corrigées de leurs biais par la méthode ADAMONT [5]. Cela signifie que les écarts systématiques entre les résultats des modèles et les observations historiques ont été identifiés et ajustés afin de rendre les projections plus précises localement.
À quel climat s’adapter en France selon la TRACC ?
Le rapport de Météo-France « À quel climat s’adapter en France selon la TRACC ? » fourmille d’informations sur l’évolution du climat en France. Y sont notamment abordés : l’évolution de la variabilité interannuelle des précipitations et des températures, l’évolution des températures et pluies extrêmes, l’évolution du risque de feu de végétation, l’évolution des tempêtes, et enfin l’enneigement en montagne. Voici quelques points clés à retenir.
Évolution de la variabilité interannuelle des températures
On observe des variations importantes d’une année à l’autre : par exemple, un été relativement frais en 2021 suivi de l’été le plus chaud de la période en 2022 (l’été 2022 est le 2e été le plus chaud observé en France métropolitaine derrière l’été 2003). Si l’on considère la période 2015–2024, l’été 2021 apparaît frais, mais il reste proche de la moyenne observée sur 2005–2014.
Ainsi, l’été 2022, très chaud à l’échelle récente, serait proche de la moyenne dans une France à +2,7 °C, et plutôt frais dans une France à +4 °C. À l’inverse, un été aussi « frais » que 2021 deviendrait quasiment impossible dans un scénario à +4 °C.
Figure 3 : Variabilité interannuelle des températures moyennes en été. À gauche sont représentées les températures moyennes des 20 étés de la période 2005-2024. La distribution de ces températures est représentée à droite avec la moyenne ainsi que le 10e percentile (valeur sous laquelle se trouve 10% des années, flèche du bas) et le 90e percentile (valeur dépassée par 10% des années, flèche du haut). Les écarts indiqués sur la figure sont calculés par rapport à la moyenne de la période 1976-2005. Source : “À quel climat s’adapter en France selon la TRACC ?” partie 2 [2].
Attention : Les écarts de température indiqués sur la figure 3 sont calculés par rapport à la moyenne de la période 1976-2005 et non pas par rapport à la période préindustrielle (1850-1900) qui est la référence habituellement utilisée pour mesurer le réchauffement. Ainsi la température moyenne des étés sur la période récente 2005-2024 est de +0,9°C par rapport à la moyenne de la période 1976-2005.
Évolution de la variabilité interannuelle des précipitations
Les fluctuations d’une année à l’autre sont marquées, avec des écarts de 20 % à 40 % par rapport à la moyenne historique. À l’avenir, les étés devraient être plus secs en moyenne.
Dans une France à +4 °C, une sécheresse comme celle de 2022 (−20 % par rapport à 1976–2005) correspondrait à un été « normal », tandis que des étés secs pourraient atteindre jusqu’à −47 % de précipitations. Toutefois, des étés plus humides que la normale resteront possibles.
La hausse des températures augmente l’évaporation et la transpiration végétale. Associée à une pluviométrie réduite, elle entraîne une baisse de l’eau disponible dans les sols, rivières et nappes phréatiques [6]. Cela affecte l’agriculture, l’industrie, la production hydroélectrique et les usages touristiques (par exemple, le niveau du lac de Serre-Ponçon en 2022). Le partage d’une ressource plus rare devient ainsi un enjeu majeur de l’adaptation.
Figure 4 : Variabilité interannuelle du cumul de précipitation en été. À gauche sont représentés les cumuls des 20 étés de la période 2005-2024. La distribution de ces cumuls est représentée à droite avec la moyenne ainsi que le 10e percentile (valeur sous laquelle se trouve 10% des années, flèche du bas) et le 90e percentile (valeur dépassée par 10% des années, flèche du haut). Source : “À quel climat s’adapter en France selon la TRACC ?” partie 2 [2].
Évolution du risque de feux de végétation
Le risque d’incendie dépend de la végétation et des conditions météorologiques. Des situations chaudes, sèches et venteuses favorisent les feux. Ces conditions sont synthétisées par l’Indice de Feu Météo (IFM).
Comme le montrent les cartes ci-dessous, le nombre de jours à risque élevé (IFM > 40) évolue d’année en année. Historiquement concentré sur les Landes et le pourtour méditerranéen, ce risque s’étend progressivement à presque toute la France, avec plus de 7 jours par an de risque élevé à l’horizon 2100. En Méditerranée, ce risque est encore plus marqué, avec un doublement des jours à très haut risque et un allongement d’un à deux mois de la saison des feux.
Figure 5 : Évolution du nombre de jours par an de risque de feu élevé (Indice de Feu Météo supérieur à 40) pour les niveaux de réchauffement France à +2°C, +2,7°C et +4°C. Les 3 colonnes représentent les valeurs minimales, médiane et maximales issues des 17 simulations de l’ensemble TRACC. Source : “À quel climat s’adapter en France selon la TRACC ?” partie 2 [2].
Évolution de l’enneigement en montagne
Le tableau ci-dessous détaille le nombre moyen de jours d’enneigement (hauteur de neige > 5 cm) par massif et par altitude, pour chacun des trois niveaux de réchauffement TRACC. Le recul de l’enneigement est généralisé, mais plus rapide en basse altitude et dans les massifs du Sud (Pyrénées, Corse, Alpes du Sud) que dans ceux du Nord.
Cette évolution affecte non seulement les stations de ski, mais aussi le stockage hivernal de l’eau, avec des conséquences pour l’hydroélectricité, l’agropastoralisme et certaines activités touristiques estivales.
Figure 6 : Nombre moyen de jours d’enneigement (> 5 cm) selon massifs et altitudes. Source : « À quel climat s’adapter en France selon la TRACC ? » (partie 2) [2].
Et maintenant, comment se servir de la TRACC ?
La TRACC a vocation a s’intégrer dans le cadre légal. Elle constitue ainsi une référence obligatoire pour les stratégies d’adaptation des collectivités et des entreprises publiques.
La TRACC met à disposition des projections climatiques détaillées (températures, précipitations, feux, tempêtes, enneigement) sur l’ensemble du territoire métropolitain, à une résolution de 8 km, accessibles via le portail Drias. Les entreprises peuvent d’ores et déjà les utiliser pour anticiper les risques, ajuster leurs investissements et planifier leurs mesures d’adaptation.
L’adaptation ne peut pas être pensée isolément : elle doit tenir compte des ressources locales, des infrastructures partagées et des autres acteurs du territoire.
En ce sens, la TRACC offre un langage commun pour dialoguer entre acteurs publics et privés, éviter la maladaptation et préparer les décisions à long terme dans un climat qui ne ressemblera plus à celui du passé.