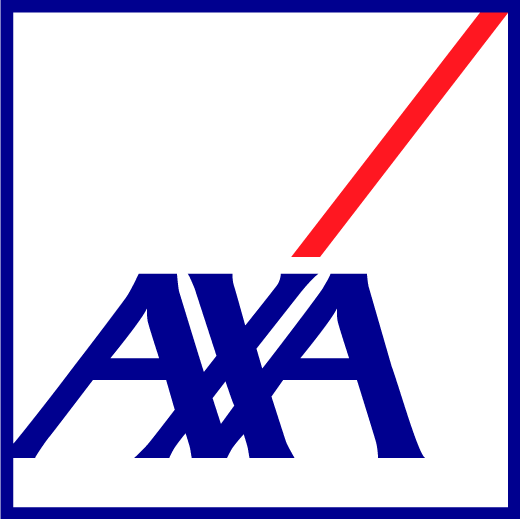Dans cet article, Olivier Boucher, climatologue, directeur de recherche au CNRS et expert au sein du GIEC, apporte son éclairage sur le changement climatique, sous l’angle des limites planétaires. Spécialiste de la modélisation du climat, il répond à cinq questions essentielles pour comprendre les enjeux actuels et futurs du réchauffement climatique : comment le mesurer, quelles sont les limites à ne pas dépasser, quels scénarios se dessinent, quels sont les impacts concrets déjà observés, et surtout, quelles solutions mobiliser pour agir efficacement.
1. Comment mesurer le changement climatique ? Que signifie cette limite à ne pas dépasser ?
Le changement climatique se mesure souvent par l’augmentation du réchauffement planétaire, actuellement estimée à +1,25°C depuis l’ère préindustrielle. Ce phénomène est étroitement lié à l’augmentation des gaz à effet de serre (GES), notamment le dioxyde de carbone (CO2), dont la concentration est passée de 280 ppm* à 420 ppm aujourd’hui, niveau auquel on ressent déjà fortement les impacts. Il devient donc impératif non seulement de freiner l’augmentation actuelle de cette concentration, mais aussi d’amorcer une baisse progressive afin de revenir dans une zone de sécurité climatique. Se rapprocher autant que possible de l’objectif de maintien du réchauffement en dessous de 2 °C, tel que fixé lors de la COP21 par les accords de Paris, est crucial. Sans cela, les événements climatiques extrêmes continueront de gagner en intensité et en fréquence, avec des conséquences locales de plus en plus graves. Chaque fraction de degré évitée peut faire une réelle différence, « il est donc essentiel d’explique Olivier Boucher.
*Ce nombre indique le nombre de molécules de dioxyde de carbone présente dans un million de molécules d’air (parties par million ou ppm).
2. Quels sont les scénarios d’évolution et pourquoi parle-t-on de neutralité carbone ?
Les scientifiques élaborent diverses trajectoires d’émissions de GES s’appuyant sur des scénarios d’évolutions socio-économiques dans le monde jusqu’à la fin du siècle. Ces différentes trajectoires plus ou moins optimistes servent à projeter l’évolution du climat. Actuellement, nous nous dirigeons vers un réchauffement de 2,5°C à 2,7°C d’ici 2100, bien au-delà du seuil de 1,5°C recommandé par l’Accord de Paris. Pour stabiliser cette évolution, la neutralité carbone devient nécessaire, elle implique de réduire drastiquement les émissions de GES pour que la quantité résiduelle émise par les activités humaines soit égale à la quantité retirée de l’atmosphère par des puits de carbone additionnels. Ces puits additionnels ne doivent pas être confondus avec les puits naturels qui absorbent déjà près de la moitié de nos émissions de CO2. «Il faut donc venir compenser nos émissions résiduelles, notamment de CO2 par des puits additionnels ». Ces puits de carbone peuvent être naturels (forêts gérées, sols agricoles) ou technologiques (captage et stockage du carbone). Cette transition nécessite des efforts concertés à tous les niveaux.
Écoutez le podcast et découvrez l’interview dans son intégralité :
Weekly Dose of Science – Limite planétaire : changement climatique
3. Quels sont les impacts concrets du changement climatique ?
Les conséquences du réchauffement sont multiples et variées.
- Augmentation des températures : les continents et les hautes latitudes se réchauffent plus vite, avec une accélération en France par rapport à la moyenne mondiale
- Phénomènes climatiques extrêmes : les vagues de chaleur deviennent plus longues, plus fréquentes et plus intenses
- Perturbation du cycle de l’eau : sécheresses accrues dans certaines régions comme le pourtour méditerranéen, tandis que d’autres subissent des inondations dues à des pluies torrentielles
- Impacts sur la biodiversité : la combinaison du changement climatique, de la déforestation et de l’acidification des océans constitue une menace majeure pour les écosystèmes
Toutes les régions sont touchées par le réchauffement climatique, mais elles ne le sont pas de la même manière. Les effets varient en fonction des caractéristiques locales. Ainsi, certaines spécificités géographiques renforcent la vulnérabilité : un exemple très évident est celui des zones côtières, particulièrement exposées à la montée du niveau de la mer et à l’érosion. D’autres territoires, comme les départements du sud-est de la France, peuvent quant à eux être confrontés à une intensification des épisodes méditerranéens (de type cévenol). Enfin, les sociétés les plus vulnérables — en raison de la pauvreté, d’une faible organisation ou d’un manque de gouvernance efficace — subissent aussi des conséquences plus sévères.

L’épisode cévenol désigne un phénomène orageux et pluvieux intense sur le sud-est de la France, des Cévennes aux Alpes. Il doit son nom au massif des Cévennes sur lequel viennent se bloquer des pluies et orages remontant de Méditerranée. Le phénomène se produit de 3 à 6 fois par an, surtout en automne et ces épisodes s’intensifient avec le changement climatique. La durée de ce phénomène n’excède que très rarement les quatre jours (Source : Météo France).
4. Comment le changement climatique interagit-il avec les autres limites planétaires ?
Le changement climatique interagit fortement avec d’autres limites planétaires, les exemples sont nombreux. Les régions confrontées à d’autres pressions environnementales, comme l’agriculture non durable ou la déforestation, peuvent non seulement voir leurs écosystèmes se dégrader et devenir plus sensibles au changement climatique, mais aussi devenir des sources importantes d’émissions de gaz à effet de serre. Le réchauffement climatique modifie aussi le cycle hydrologique, en intensifiant l’évaporation et en perturbant la répartition des précipitations, ce qui affecte les ressources en eau. L’absorption du CO₂ atmosphérique par les océans entraîne une baisse du pH de l’eau, nuisant à de nombreuses espèces marines. Les coquillages, les coraux ou le plancton ont plus de mal à former leur squelette ou leur coquille, perturbant l’ensemble de la chaîne alimentaire océanique. Le climat accentue l’effondrement de certaines espèces, notamment en perturbant leurs habitats ou leurs cycles de reproduction.
Une autre approche consiste à réduire les pressions biologiques, par exemple en retirant des prédateurs comme les étoiles de mer, qui menacent les coraux affaiblis. D’un point de vue chimique, des essais ont été menés sur de petits récifs avec l’ajout de matériel alcalin (des bases) pour neutraliser l’acidification et favoriser la calcification. Les premiers résultats indiquent une meilleure calcification des coraux dans ces conditions.
Enfin, des solutions fondées sur la nature sont également envisagées, comme la restauration de mangroves, qui contribuent à la résilience des littoraux en protégeant les populations humaines face aux événements extrêmes.
Pour plus d’informations sur l’adaptation au changement climatique, découvrez notre article sur : les 15 impacts concrets du changement climatique
5. Quels sont les leviers d’action pour un changement durable ?
Concernant le réchauffement climatique, il n’y a pas de solution miracle. Dans l’idéal, il faut jouer avec tous les leviers dont on dispose et les activer en simultané.
Atténuation
Réduire les émissions de GES est indispensable pour limiter le réchauffement. Cela passe par des politiques climatiques ambitieuses, des transitions énergétiques et des efforts mondiaux.
Adaptation
L’adaptation consiste à minimiser les impacts inévitables du changement climatique. Les solutions incluent la gestion des ressources en eau, la résilience des infrastructures et les pratiques agricoles durables.
Il faut utiliser ces deux leviers sur différentes échéances. Selon Olivier Boucher : « Les solutions fondées sur la nature, telles que la reforestation, permettent de combiner adaptation et atténuation. Quand on arrive à faire à la fois de l’adaptation et de l’atténuation, là effectivement, c’est le graal » .
Les entreprises ont un rôle clé à jouer dans la lutte contre le changement climatique. Voici des leviers essentiels pour agir :
- Bilan carbone : identifier les émissions directes et indirectes pour mieux les réduire
- Scope 3* : agir sur la chaîne d’approvisionnement, favoriser la sobriété numérique et concevoir des produits plus respectueux de l’environnement
- Reporting extra-financier : la transparence sur les émissions devient un avantage compétitif pour attirer les talents, séduire les consommateurs et réussir économiquement
Le changement climatique n’est pas une fatalité, mais il nécessite une action immédiate et concertée. Les stratégies d’atténuation et d’adaptation sont complémentaires, tout comme les efforts individuels, technologiques et financiers. En réorientant les investissements, en adoptant des politiques climatiques ambitieuses et en misant sur des solutions basées sur la nature, nous pouvons bâtir un avenir résilient et durable.
*Les scopes 1, 2 et 3 représentent les différentes grandes catégories d’émissions de gaz à effet de serre d’une organisation. Le scope 3 comprend en général la très grande majorité des émissions indirectes liées aux activités d’une entreprise.
________________________________________
Olivier Boucher est un climatologue français, directeur de recherche au CNRS et directeur adjoint de l’Institut Pierre-Simon Laplace à Paris. Auteur principal du groupe de travail 1 du GIEC, c’est un spécialiste dans la modélisation du climat et les changements climatiques. Ses recherches couvrent le méthane, les particules atmosphériques, les traînées d’avions et les trajectoires de décarbonation. Il travaille sur des solutions pour lutter contre le changement climatique, comme la reforestation, la capture du CO₂ atmosphérique via la biomasse et la réduction des émissions de gaz à effet de serre non liés au CO₂. Selon lui, la mesure, la compréhension et l’action sont aujourd’hui essentielles, mais il n’existe aucune « solution miracle ». “Nous devons agir collectivement en mobilisant trois leviers spécifiques : les leviers technologiques, organisationnels et individuels”.