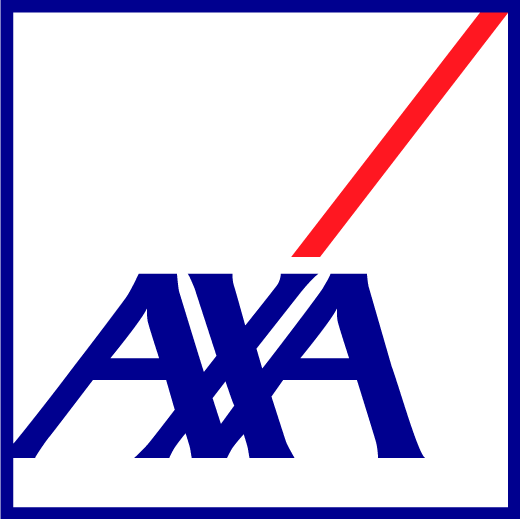Sécheresses historiques, canicules en Méditerranée, réservoirs à sec en Espagne, tensions autour du Nil ou du Mékong : l’eau douce est au cœur des crises environnementales. En septembre 2023, les chercheurs ont confirmé que la limite planétaire de l’eau douce est franchie, c’est-à-dire que l’humanité dépasse les seuils soutenables d’utilisation de l’eau bleue (prélèvements dans rivières, lacs, nappes) et de l’eau verte (eau de pluie utilisée par les sols et la végétation). Comprendre ces enjeux est essentiel pour l’adaptation, la résilience des territoires et la planification économique.
Hydrologue, biogéochimiste et modélisateur, Nicolas Flipo (École des Mines de Paris) répond ici à cinq questions
structurantes pour relier cycle hydrologique, limites planétaires et décisions publiques/privées.
1. En quoi le cycle de l’eau est-il aujourd’hui perturbé ?
Le cycle de l’eau repose sur des échanges constants entre océans, atmosphère et continents : chaque année,
environ 500 000 km³ s’évaporent des océans et 450 000 km³ y retombent en pluie, le déficit étant compensé par les précipitations
continentales. Les plantes évaporent près de 70 000 km³ par an ; cette eau rejoint l’atmosphère avant de retomber en pluie.
Selon Nicolas Flipo, l’anthropocène rompt la stabilité de l’Holocène : nos activités
(déforestation, agriculture intensive, urbanisation, industrialisation) modifient la répartition des pluies, la qualité des sols
et la disponibilité en eau. Résultat : des régions basculent en stress hydrique durable,
où la demande dépasse les ressources, touchant déjà plus d’un milliard de personnes.
2. Quelles activités humaines consomment le plus d’eau ?
L’agriculture est le principal consommateur d’eau douce, représentant 80 % des prélèvements mondiaux. L’irrigation des cultures nécessite d’énormes volumes d’eau, souvent pompés dans les nappes souterraines, avec un impact direct sur les réserves stratégiques.
« L’eau agricole est à 80 % de l’eau verte, car ce sont les plantes elles-mêmes qui la consomment et la transpirent vers l’atmosphère. »
À lire aussi : “Perturbation des cycles de l’azote et du phosphore” – Sylvain Pellerin, directeur de recherche à l’INRAE, répond à cinq questions essentielles.
L’énergie arrive ensuite : le refroidissement
des centrales thermiques ou nucléaires mobilise une part importante de l’eau bleue (≈ 30 % en Europe, ≈ 5 %
dans le monde). L’industrie (textile, électronique, agroalimentaire) et les usages domestiques
complètent le tableau. Mais, attention à une subtilité souvent méconnue :
« Une eau prélevée n’est pas toujours consommée. Une centrale peut prélever beaucoup d’eau pour refroidir, mais la restituer ensuite dans le milieu, tandis que l’irrigation agricole consomme presque tout ce qu’elle prélève, car l’eau repart dans l’atmosphère. »
3. Quels sont les risques pour les entreprises et les territoires ?
La rareté de l’eau génère des impacts systémiques : baisses de rendements agricoles et tensions
alimentaires, limitations de production électrique en période chaude faute de refroidissement, vulnérabilité des secteurs
hydro-intensifs (ex. l’industrie textile, électronique, etc.). La numérisation est aussi concernée : data centers et
micro-électronique exigent des volumes d’eau très purs.
« L’empreinte hydrique des produits devient stratégique : un t-shirt en coton ≈ 2 500 L, 1 kg de viande rouge jusqu’à ≈ 10 000 L (contre ≈ 1 000 L pour 1 kg de légumes). Les échanges mondiaux déplacent une « eau virtuelle » ; par exemple, l’import de soja pour l’alimentation animale en France exerce une pression hydrique à l’étranger. »
4. Quelles sont les solutions pour restaurer le cycle de l’eau ?
Priorité : atténuer le changement climatique, car chaque degré supplémentaire intensifie sécheresses et
extrêmes hydrologiques. Sur le terrain, il faut ralentir le ruissellement (haies, bandes enherbées,
agroforesterie) pour favoriser l’infiltration, restaurer zones humides
et plaines inondables pour recharger les nappes, réduire pertes et gaspillages dans
l’agriculture et les réseaux urbains, et faire évoluer les régimes alimentaires vers plus de végétal
(diminuer la part de protéines animales peut diviser par dix l’empreinte hydrique).
Pour les entreprises, il s’agit de repenser les chaînes de valeur et de mutualiser les efforts avec les acteurs d’un territoire.
« La gestion de l’eau ne peut pas être individuelle. Elle doit être collective et territoriale » précise Nicolas Flipo.
5. Quelles perspectives scientifiques et quelles innovations ?
La recherche s’oriente vers des modèles intégrés, capables de connecter le cycle de l’eau aux systèmes alimentaires, énergétiques et industriels.
« Nous travaillons à modéliser des scénarios de transition qui intègrent à la fois les flux d’eau, le climat et les usages humains. »
Côté technologies, les usines de dessalement ou d’ultrafiltration vont se multiplier, malgré leurs coûts énergétiques et impacts écologiques.
« Dans certains territoires insulaires ou arides, le dessalement est déjà la seule solution viable. Mais il faudra l’alimenter par des énergies renouvelables pour en réduire l’empreinte carbone » précise Nicolas Flipo.
Enfin, la clé réside aussi dans la réorganisation territoriale. Les entreprises doivent collaborer avec les collectivités pour restaurer les zones d’expansion des crues, ralentir les flux et mutualiser les ressources.
La crise de l’eau n’est pas seulement une crise environnementale : c’est une crise systémique, qui engage les modèles agricoles, énergétiques, économiques et sociaux. Dans un monde contraint par les limites planétaires, l’eau devient un facteur critique de résilience.
Nicolas Flipo conclue ainsi : « On ne sait pas faire pleuvoir. Mais on peut ralentir, stocker, réorganiser. C’est là que réside notre pouvoir d’agir. »
____________________
À propos de l’expert
Nicolas Flipo est directeur de recherche à l’École des Mines de Paris (Université Paris Sciences et Lettres). Hydrologue, biogéochimiste et modélisateur, il étudie les interactions entre cycle hydrologique, dynamiques climatiques et pressions anthropiques. Il a dirigé pendant dix ans le programme interdisciplinaire PIREN-Seine, consacré à la ressource en eau du bassin de la Seine, plus grand réservoir d’eau souterraine d’Europe. . Ses travaux portent sur la modélisation des flux et des stocks d’eau, l’évolution des usages de l’eau à l’échelle des territoires, ainsi que la quantification des impacts liés à l’agriculture, à l’énergie et à l’urbanisation.
Spécialiste reconnu de l’approche systémique, il mobilise des outils de modélisation multi-échelle pour relier les composantes physiques, écologiques et sociales du cycle hydrologique. Il contribue activement à la réflexion sur l’empreinte hydrique, les limites planétaires, et les leviers d’adaptation basés sur la nature.