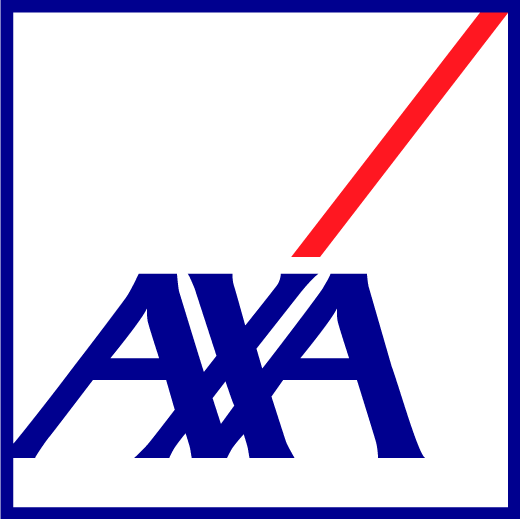Face à un taux d’extinction des espèces jusqu’à 1 000 fois supérieur au rythme naturel, il devient urgent de comprendre les pressions qui pèsent sur les écosystèmes et les conséquences pour nos sociétés.
Pour parler de l’érosion de la biodiversité, 5 questions sont posées à Céline Bellard, biologiste et chercheuse au CNRS. Ses travaux se concentrent sur la biologie de la conservation, les invasions biologiques, et la perte de biodiversité. Céline va explorer la limite planétaire liée à la biodiversité, ses causes profondes, ses impacts systémiques, et les leviers pour inverser cette trajectoire.
1. Comment mesure-t-on la biodiversité et pourquoi cela reste-t-il un défi scientifique ?
Mesurer la biodiversité est une tâche extrêmement complexe en raison de la diversité des formes de vie et des échelles d’analyse. Comme le souligne Céline Bellard, « un des indicateurs, c’est le nombre d’espèces. Mais pour compter les espèces, déjà, c’est un travail colossal » ! Cela concerne aussi bien les espèces terrestres que celles des milieux marins, souterrains ou microbiens.
Elle rappelle d’ailleurs qu’on estime le nombre total d’espèces sur Terre entre 2 et 100 millions, une fourchette qui montre à quel point une part importante reste inconnue.
Mais au-delà du simple comptage, les chercheurs s’intéressent aussi à « la biomasse, l’abondance ou même le rôle des espèces au sein des écosystèmes ».
Cette dernière dimension correspond à la diversité fonctionnelle, soit la capacité d’une espèce à remplir un rôle écologique (pollinisation, décomposition, prédation, etc.). Céline insiste aussi sur l’importance des communautés d’espèces, c’est-à-dire l’ensemble des interactions entre une espèce et les autres dans son habitat : « Est-ce que ça va être une proie, un prédateur, une ressource, en compétition ? ». Ainsi, chaque méthodologie permet de saisir une facette différente de la biodiversité, ce qui rend sa cartographie d’autant plus ardue.
2. Pourquoi parle-t-on de « limite planétaire » pour la biodiversité, et comment est-elle quantifiée ?
La biodiversité est aujourd’hui considérée comme une limite planétaire dépassée, c’est-à-dire un seuil au-delà duquel les conséquences deviennent de plus en plus graves et difficiles à maîtriser pour les écosystèmes et les sociétés humaines. Stockholm Resilience Center a réussi récemment à chiffrer cette limite en s’appuyant sur deux indicateurs principaux : le taux d’extinction des espèces et leur perte de diversité génétique et fonctionnelle.
Céline Bellard explique que si « les extinctions d’espèces sont un phénomène naturel », les taux actuels sont « entre 100 et 1 000 fois supérieurs aux taux qu’on retrouve dans les données fossiles ». C’est donc la vitesse des extinctions qui est préoccupante, car elle empêche les écosystèmes de s’adapter ou de se reconstituer. La biologiste précise que cette mesure intègre « la perte de diversité génétique mais également fonctionnelle », c’est-à-dire la disparition de rôles clés dans les écosystèmes.
La biodiversité ne se réduit donc pas à un inventaire d’espèces : sa dégradation affecte directement les équilibres écologiques et les services rendus à l’humanité.

« La nature décline globalement à un rythme sans précédent dans l’histoire humaine et le taux d’extinction des espèces s’accélère, provoquant dès à présent des effets graves sur les populations humaines du monde entier », alerte l’IPBES.
3. Quelles sont les pressions principales sur la biodiversité, et quelles conséquences en résultent pour les humains ?
Cinq grandes pressions ont été identifiées comme responsables du déclin actuel de la biodiversité. Reprenant les conclusions de l’IPBES (l’équivalent du GIEC pour la biodiversité), la biologiste cite :
- la perte d’habitat (déforestation, urbanisation)
- la pollution (des sols, des océans, lumineuse)
- le changement climatique
- les invasions biologiques
- la surexploitation des ressources
Ces pressions interagissent entre elles, aggravant les effets. Par exemple, les pesticides provoquent à la fois une pollution des sols et le déclin des pollinisateurs. Or, ces derniers sont essentiels : « plus de 80 % de la pollinisation en Europe se fait par des pollinisateurs sauvages », rappelle Céline. Leur disparition implique un effondrement de la productivité agricole. Dans certaines régions, « la pollinisation s’effectue à la main », notamment pour des cultures comme la vanille. La perte de biodiversité signifie aussi la perte d’accès à des ressources médicinales, alimentaires ou encore de régulation écologique.
Céline souligne que « tous les services que la biodiversité rend à l’homme peuvent être mis en péril », menaçant donc la sécurité alimentaire, la santé humaine, et l’équilibre des sociétés.
Écoutez le podcast et découvrez l’interview dans son intégralité : l’érosion de la biodiversité.
4. Quel est le lien entre biodiversité, climat et les autres limites planétaires ? Les entreprises peuvent-elles jouer face à ces enjeux ?
Le lien est double : « le climat va régir la distribution des espèces » et la dynamique des écosystèmes, et, en retour, la santé des écosystèmes influence aussi le climat. Céline rappelle que « les océans, les forêts, les tourbières sont des zones de stockage de carbone important », et que leur dégradation affaiblit leur capacité à atténuer les effets climatiques.
Ainsi, « à partir du moment où la biodiversité est dégradée, elle ne peut plus remplir son rôle de stockage de carbone », ce qui accentue le réchauffement climatique.
La perte d’un habitat naturel, comme une forêt remplacée par un sol nu, ne permet plus de jouer ce rôle de régulation. Cela peut amplifier le réchauffement local, mais aussi favoriser des phénomènes comme l’érosion des sols ou les inondations. « À partir de ce moment-là, on a un effet en chaîne », où les différentes limites planétaires, climat, biodiversité, usage des sols, interagissent et se renforcent mutuellement dans leur dérèglement.
5. Quelles solutions concrètes peut-on mettre en œuvre à tous les niveaux pour enrayer la perte de biodiversité ?
Il est crucial pour les entreprises de commencer par mesurer leur impact.
Bien que l’empreinte carbone soit aujourd’hui largement quantifiée, celle sur la biodiversité est encore émergente. Céline cite deux outils : « l’UE Business for Biodiversity » et « le Global Biodiversity Score » développé par la CDC Biodiversité, qui permettent aux entreprises de mesurer leur empreinte biodiversité.
Elle reconnaît cependant que « chiffrer son impact sur la biodiversité, ça sous-entend qu’on chiffre la biodiversité connue », or une immense partie reste encore inconnue. Malgré cette incertitude, elle considère la mesure comme une étape fondamentale : « cela permet de faire un état de l’art de son rôle et d’établir des objectifs de réduction d’impact ».
Ensuite la réponse à la crise de la biodiversité repose sur des actions coordonnées à plusieurs échelles, des gouvernements jusqu’aux citoyens. À l’échelle nationale, la scientifique souligne l’importance de « mettre en place des aires protégées strictes », qui permettent de maintenir des habitats non perturbés.
Les collectivités locales peuvent limiter la fragmentation des habitats par une urbanisation maîtrisée et le maintien d’espaces naturels en ville. À l’échelle individuelle, des gestes comme « ne pas bétonner son jardin, planter des fleurs sauvages, préserver les haies entre les cultures » favorisent le retour d’une faune diversifiée.
Concernant la consommation, elle appelle à « manger moins de viande, consommer local, et privilégier l’agriculture biologique ». Ces choix réduisent l’utilisation de pesticides, ce qui est bénéfique tant pour notre santé, que pour la biodiversité et pour la fertilité des sols. Céline insiste aussi sur la capacité de la biodiversité à nous aider à nous adapter : « Les écosystèmes sont capables d’être résilients au stress », à condition qu’ils soient diversifiés. Cette diversité est essentielle car « plusieurs espèces peuvent remplir la même fonction et remplacer une espèce disparue ». En somme, la diversité est la clé de la résilience. Elle conclut avec un message fort : « On peut tous contribuer à limiter l’impact de l’homme sur la biodiversité. »
______________________________
Céline Bellard est biologiste et chercheuse au CNRS, actuellement rattachée au laboratoire Écologie, Systématique et Évolution de l’université Paris-Saclay. Soutenue par le Fonds AXA pour la Recherche, elle s’est spécialisée dans l’étude de la biodiversité, en particulier les invasions biologiques et la vulnérabilité des écosystèmes. Elle a mené des travaux postdoctoraux à l’University College de Londres et se consacre aujourd’hui à des recherches sur la biologie de la conservation, avec un focus sur la perte de biodiversité et l’extinction des espèces. En parallèle de son activité scientifique, Céline s’implique dans la vulgarisation scientifique et la promotion des femmes dans les sciences à travers le programme Girls in Science de la Fondation L’Oréal. En 2022, elle a reçu le Prix Irène Joliot-Curie – Prix spécial de l’engagement.